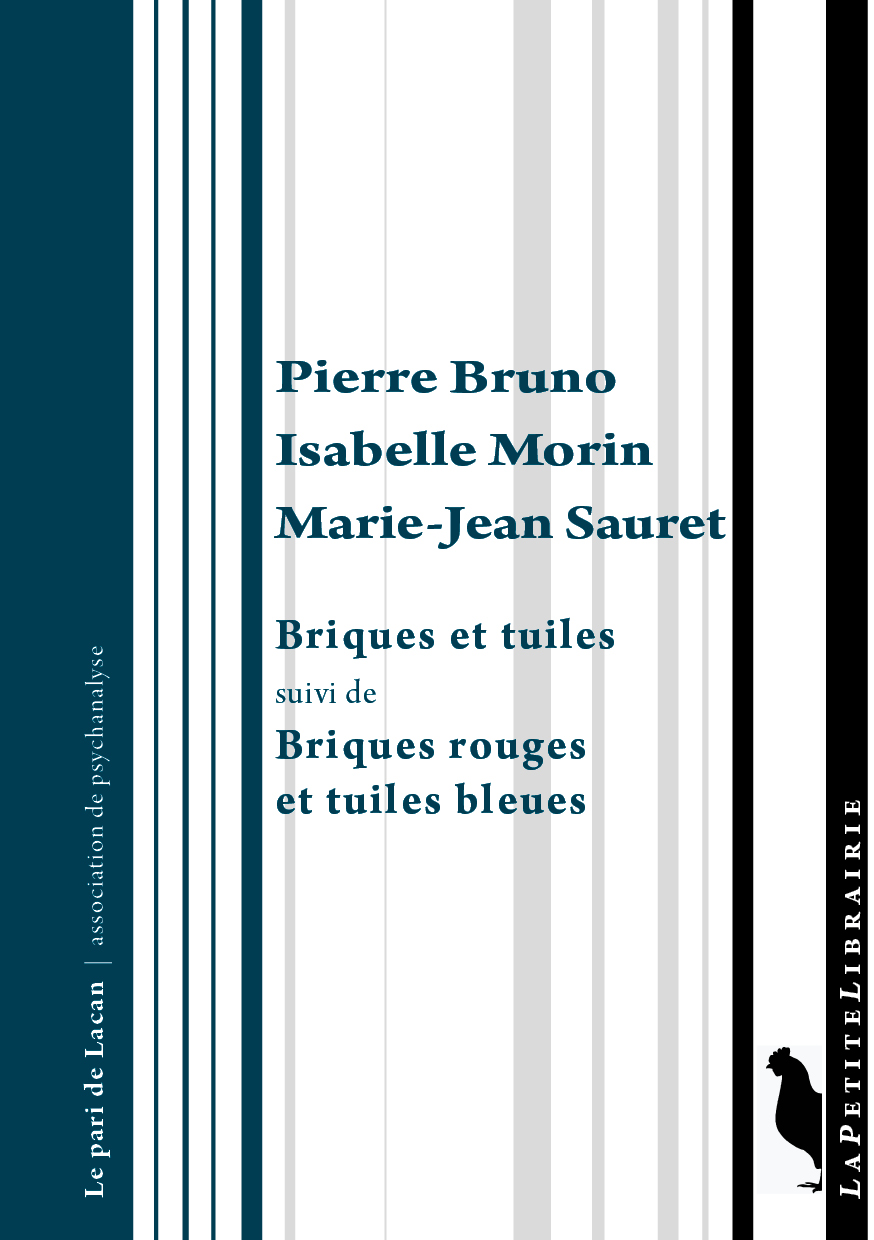41 en stock
Lettre n°1 -septembre 2020
A propos de Briques et tuiles
par Rémi Brassié
Ce livre recueille des lettres échangées via une liste de discussion. Le séminaire Briques et tuiles inaugurait une forme singulière de travail, dans un contexte sur lequel Pierre Bruno s’explique suffisamment pour qu’il n’y ait pas à y revenir. Pourtant, ce séminaire n’est pas un séminaire de circonstance, ce qui donne raison à LaPetiteLibrairie de le mettre en circulation. Il n’y a plus qu’à veiller aux échos qui y seront donnés.
Ces « briques et tuiles » ont leur fondation dans l’histoire de la psychanalyse, puisque c’est à partir de la question du père réel, qui a fait scission il y a déjà plus de vingt ans, et qui continue d’agiter aussi bien nos cogitations que nos associations. La question est clinique mais comme le démontre ce livre, on ne peut la dissocier de la question du « faire école ». Elle touche ainsi à ce qui fonde le fait qu’il puisse y avoir une cure psychanalytique autant que la psychanalyse dans le sens de ce qui transcende les associations ou écoles. Si ce livre s’adresse à ceux qui sont membres d’une association de psychanalyse, nul doute que tout un chacun pourra y trouver de quoi s’orienter dans les questions que lui pose la psychanalyse.
Il s’agit d’y suivre le sillon lacanien : savoir ce qui fonde la psychanalyse comme une pratique qui ne saurait appartenir ni à la psychologie, ni à la philosophie, ni à la médecine ou toute autre discipline connexe. Fonder la psychanalyse dans le réel, si c’est bien un projet dans lequel se reconnaissent nos trois auteurs, c’est s’assurer qu’elle ne relève ni du délire, ni de l’idéologie. Qu’elle soit fiable donc, pour traiter les démêlés de l’humain avec son malaise, qu’on puisse lui faire confiance, à nouveau. Car l’air du temps offre à nos contemporains une profusion de techniques où l’on voit un retour en force de la suggestion, par où le discours du capitaliste s’infiltre sans dire son nom. Redonner à la psychanalyse sa fonction de subversion et permettre qu’elle sorte du désamour où on la tient de plus en plus, tel est l’intention qui se lit dans ces lettres.
La question du père réel n’est pas un détail, car à le confondre avec le père imaginaire (de la horde), une analyse a peu de chances de parvenir à son terme. Pierre Bruno revient sur cette question puisqu’elle permet également de formuler sa raison et sa façon d’être membre d’une association : en exclusion interne. Isabelle Morin introduit dans ces échanges la question du transfert, toujours sans découper artificiellement l’intension et l’extension. Elle y pose après le roc freudien de la castration, la question d’un roc lacanien et de son dépassement. Quant à Marie-Jean Sauret, restant lui aussi dans l’intrication de la cure et de la communauté, il interroge plus spécifiquement les incidences de cette thèse sur le lien social, donc de la psychanalyse dans la politique.
La forme de ce séminaire nous a suggéré celle d’une interview par laquelle nous invitons les lecteurs à entrer dans l’ouvrage. Nul doute qu’il invitera à de nouvelles briques. Laissons donc la parole aux auteurs.
Trois questions aux auteurs
Rémi Brassié : Pierre Bruno, vous poursuivez dans ce livre le sillon lacanien. Votre thèse sur le père réel se déroule avec clarté, d’abord comme question sur le statut de l’x du tableau de la sexuation, puis par l’équivalence du a et du père réel et enfin par l’insuffisance de l’être de filiation et le passage à l’être de symptôme. Il est remarquable d’ailleurs de lire sous la plume d’Isabelle Morin et de Marie-Jean Sauret des élucidations qui sont aussi pour vous l’occasion de rebonds pour clarifier votre apport. La clarté de la thèse ne signifie pas pour autant qu’on puisse en tirer toutes les conséquences. La question de savoir si vous êtes suffisamment entendu reste donc entière. Ce que vous précisez du contexte dans lequel se séminaire a été tenté démontre que rien n’est moins évident. Ce qui s’introduit ensuite avec la question de l’insuffisance de l’être de filiation et le passage à l’être de symptôme suggère que chacun de nous doit assumer le crime par lequel il peut assumer son désir de vivre. La question de la haine apparaît-elle alors ? Lacan n’hésitait pas à qualifier notre civilisation de « civilisation de la haine » (Lacan, 7 juillet 1954), du fait du discours commun. Que pourriez-vous dire, au regard de votre thèse sur le père réel quant à la haine et son destin, dans la cure, dans la psychanalyse et la civilisation ?
Pierre Bruno : Il est toujours nécessaire de ne pas se précipiter dans le direct d’une réponse, pour éviter de rendre définitivement consistant le savoir, qu’il s’agit non de combler, mais dont il s’agit de détourer le trou. Ce n’est donc pas chiqué ni afféterie que de préférer le crochet, voire le swing, au direct. La haine est une passion, et je ne suis pas sûr qu’on puisse saisir ce qu’elle est à simplement la tenir pour l’autre face de l’amour. Le plus pertinent est de se servir du contrefort de Lacan, soulignant dans Encore que la haine a permis à un tel et un tel de bien le lire. Cela est assez clair : la lecture, pour ne pas virer à un enregistrement numérique, doit pouvoir démonter les arcanes de l’écrit et ne pas les transformer en colonnes de temple. C’est le minimum. Est-ce à dire que la « civilisation de la haine » (1954) doit se lire après-coup comme la civilisation des au-moins uns lecteurs ? Soyons prudent : la haine n’est pas une condition de la lecture. Sans un transfert positif, pour m’en tenir à cette expression simple, pas de vraie lecture. L’amour n’est une passion que s’il s’inscrit dans une « Guerre froide » (voir le film de Pawel Pawlikowski Cold war) avec le ou la partenaire. « Le nouvel amour » va au-delà, bien qu’on ne sache pas réellement ce que c’est. Je dirais donc volontiers que la haine vise la destruction de l’autre, en tant que non-compatible avec l’univers du haïsseur. A suivre les indications de Freud dans Die Verneinung (1925), la haine serait du niveau de l’expulsion de l’autre, et serait liée à la non acquisition du non, puisque le non est ce qui permet d’admettre dans le champ subjectif quelque chose de refoulé, sous la forme du dénié (différent du démenti).
Il me semble, de ce dernier point de vue, que la haine a une relation avec la seconde mort, celle qui vise non pas la mort (biologique) de l’autre ou de moi-même, mais vise à annihiler l’événement de sa naissance. Il n’a pas vécu (Non vixit) n’a rien à voir avec il ne vit pas ou plus (Non vivit). La haine ainsi voudrait non pas tuer le vivant, mais effacer la trace que le vivant à laissée. Quand Créon interdit à Antigone d’ensevelir son frère Polynice selon les rites, c’est parce qu’il veut faire mourir Polynice une seconde fois. Ce à quoi Antigone s’oppose, parce qu’elle veut rester fidèle à l’até, c’est-à-dire à la filiation pourtant terrible des Labdacides. Até, c’est l’égarement, la folie (il existe, comme toujours chez les grecs, une déesse pour l’incarner). Autrement dit, la fidélité à l’être de filiation consiste à s’approprier le crime parental (qui est, toujours, le fait d’avoir mis un monde un être qui ne pouvait pas le désirer). Dès lors, il y a quelque chose qui cloche, dans cette exigence de la filiation : consentir au crime de l’Autre pour pouvoir de ne pas être soustrait à l’Autre, et le symptôme traite cette contradiction. Remarquons alors qu’il ne traite pas cette contradiction par la haine. À ce titre, le symptôme est une garantie contre la haine. Traquer le symptôme, pour l’éradiquer au lieu de l’interpréter, on voit à quoi ça mène.
R.B. : Isabelle Morin, vous introduisez très vite la question de l’amour et du transfert dans ce séminaire. Vous ramenez très rigoureusement à la cure, sans jamais lâcher le fil de l’association de psychanalyse. La passe y trouve ainsi une justification argumentée. Votre examen précis de la question de la cure vous conduit à partir du roc de la castration, « roc freudien » dites-vous, à poser la question du « roc lacanien » de la cure. On peut comprendre qu’il s’agit de la question du père réel, de l’incastrable, peut-être préciserez-vous davantage cela. Vous posez également la question de l’au-delà de ce roc lacanien, qui appelle sûrement à des développements. Que pourriez-vous nous dire aujourd’hui de ce cap aussi bien pour la cure que quant au « faire école » ?
Isabelle Morin : Évoquer un roc lacanien de la cure est salutaire car aucune expérience ne peut être close. Utiliser la métaphore d’un roc veut dire qu’on s’y cogne et que pour passer, il faut le déplacer.
Freud a parlé du roc de la castration chez ses analysants pour désigner une impossibilité à traiter leur rapport à la castration qui leur permettrait de franchir le pas nécessaire pour traiter le transfert et conclure la cure de la bonne façon. La bonne façon sera celle qui aura des incidences, sur les autres, sur la position de l’analyste et sur une éthique nouvelle.
On mesure actuellement les effets de la direction des cures en considérant par exemple l’enseignement de la passe, mais aussi en se penchant sur les effets sur le discours analytique au regard de la « maturité » des associations de psychanalyse. On peut par exemple considérer que la façon dont elles organisent la transmission et la recherche pour que le savoir de l’inconscient ne reste pas lettre morte, leur capacité à penser le travail sans maître, mais pas sans analyste, ou encore la capacité à traiter les questions ensemble (logique collective), seraient les jalons d’une maturité qui conviendrait aux avancées du discours analytique.
Pourtant on constate que de nombreuses associations continuent à s’organiser sur le versant de « l’envers de la psychanalyse », comme un effet de démenti de la psychanalyse aussitôt sorti des cures. Est-ce la conséquence directe de choses non résolues dans les analyses ou la force du démenti ?
Les psychanalystes actuels peuvent-ils « dépasser la passe » et faire bouger la direction des cures ? Je n’ai pas de réponse à priori. Je constate simplement que la quasi-impossibilité de communications entre association, la verticalité des organisations qui n’est pas sans rappeler la critique de Lacan sur la psychanalyse en 1956, sont autant de signaux d’un « inguérissable ». Quand la répétition va-telle cesser dans les institutions ou les associations de psychanalystes ?
Lacan a voulu donner la chance en 1967 aux analystes d’entendre autre chose que le discours des AME dans son école, en créant les AE, juste sortis de l’œuf de leurs cures, mais où est passé cette naïveté attendue qui nous enseignerait ? La réponse n’est pas du côté de la place qu’on leur fait ou pas, mais d’oser sans Autre de l’Autre sur le fil de ce que l’on a appris de sa cure.
Les inventions de Lacan ont été remarquables si on suit pas à pas, la critique qu’il fait des effets de l’institution qu’il a lui-même crée. (Silicet de 1967 à 1973).
Ce roc lacanien concerne-t-il le père réel et l’incastrable, il y a certes une difficulté à faire entendre les conséquences pour la direction des cures de cette thèse. Mais il me semble que le père réel est plutôt ce qui a permis de dépasser le roc freudien de la castration. Car Freud s’est arrêté sur le père mort or c’est le père vivant qui assume sa mission de père, celle de transmettre la castration, qui aurait peut être permis de déplacer le roc freudien.
Reste donc ouverte la question du roc lacanien dans la direction des cures aujourd’hui. Ce dépassement concernera peut-être la jouissance.
R.B.: Marie-Jean Sauret, vous introduisez la question de la politique dans ce travail. On peut y lire combien le psychanalyste est engagé dans la politique et comment la psychanalyse permettrait de penser la politique qui conviendrait à l’humain tel qu’on peut l’appréhender depuis que Freud nous a ouvert la voie. On sait pourtant que la psychanalyse ne se transmet vraiment que par la cure et que tout espoir pédagogique est vain comme Freud le rappelait en son temps. On sait aussi que malgré tout, quelque chose de Freud a pu arriver jusqu’à nous malgré la confusion qu’introduisent certaines traductions. Vous appuyant sur ce que Pierre Bruno dit du symptôme, soit que lui seul sait, vous indiquez pour la politique la voie du symptôme, du non-rapport, façons de faire à l’altérité une place. Seul le discours analytique permet de penser cette organisation. On peut alors avoir l’idée que faire une analyse ouvre à cette possibilité de penser un lien social vivable pour tous : la cure est-elle la seule voie possible pour pouvoir penser la politique ? Le non-analysant peut-il trouver un secours dans le dire analytique ? Au fond, pour faire écho à la question de la haine posée à Pierre Bruno, et à l’évocation de l’amour dans la question à Isabelle Morin, on peut vous demander si la fonction de l’ignorance, telle que Lacan la fait valoir dans la psychanalyse peut avoir sa place dans la politique.
Marie-Jean Sauret : L’analyste extraie le point d’appui de son enseignement de sa cure, mais il enseigne comme analysant à partir du non analyste en soi. Il ne cesse de s’expliquer avec ce qui met savoir et discours analytiques en échec. Enseigner comme analysant suppose une part inanalysée, à quoi le Discours Analytique constitué ne répond pas mais fait une place. La transmission de la psychanalyse implique cette limite où la psychanalyse est impossible : seulement là elle se réinvente. L’inanalysé n’est donc pas réservé au non analysant : peut-être faut-il commencer par reconnaître ce qui fait la vertu de cet inanalysé et sa mise en fonction comme raison du désir de l’analyste pour avoir chance de faire école auprès du non analysant. La pertinence de ce savoir ne tient qu’à son rapport au Discours analytique.
L’énigme du sujet est celle qu’il reçoit du signifiant du fait de la distance infranchissable (le non rapport) que celui-ci met à la Chose : que suis-je réellement ? Le savoir de la Chose, de son être de jouissance, est indisponible, insu (Unbewusst), inconscient. « L’inconscient, ce n’est pas que l’être pense », « c’est que l’être, en parlant, jouisse », et « ne veuille rien en savoir de plus », « ne veuille rien en savoir du tout » (Le Séminaire, Livre XX : Encore) : ne veuille rien savoir de ce que la sexualité introduit comme manque fondamental, que la castration permet de symboliser. De cette ignorance fondamentale naîtraient en un sens toutes les passions, toutes les distractions (passion de l’ignorance, génitif subjectif).
Il ne revient pas au même que ce qui fait énigme concerne le sujet ou le monde. L’angoisse signale au sujet la proximité de la rencontre qu’il souhaite éviter (vers quoi l’accompagnera la cure éventuelle), tandis que l’ignorance oriente le savant vers une promesse de trouvailles scientifiques. Il n’est pas exempté pour autant de l’angoisse qui surgit à nouveau devant les conséquences éventuelles de ses découvertes.
Ce qu’il convient de faire de la science relève de l’éthique et de la politique. La science n’en dit mot, d’où l’appel au Discours du maître, à la politique. Notre époque témoigne d’une réelle passion de l’ignorance (génitif objectif) : avec le numérique, les nouvelles technologies, (sur fond d’économisme) elle développe une idéologie du tout évaluable et calculable qui prétend résoudre scientifiquement toutes les questions. Ainsi le scientisme suture-t-il tendanciellement la division du sujet et masque-t-il à ce dernier l’énigme qui le concerne. Cette logique ne voit pas que, ce réalisant, elle asphyxie le sujet – elle le prive de ce trou dans le savoir dont le désir du savant lui-même se soutient pour l’investir dans les recherches qui pourtant l’angoissent.
De sorte que d’un côté il nous faut prendre au sérieux les passions qui dévorent notre époque et qui pourraient résulter d’un rejet du trou dans le savoir, de l’ignorance, d’une transformation du « je n’en veux rien savoir » de l’inconscient en certitude quasi paranoïaque. Et, d’un autre, sans doute avons-nous à réhabiliter une passion pour l’ignorance susceptible d’accueillir l’énigme du sujet, condition d’un véritable lien social. Oui, le roman, le cinéma, l’artisanat, etc. témoignent d’une résistance qui donne à penser que les effets du Discours Analytique ne sont pas limités à la cure. Mais il est clair qu’un lien social « viable et vivable » est impossible à obtenir sans l’ex-sistence du discours analytique aux autres discours.
Nous remercions chaleureusement Pierre Bruno, Isabelle Morin et Marie-Jean Sauret pour ces réponses qui ouvrent à des échanges que nous souhaitons nombreux autour de ce livre qui ouvre aux lecteurs de nombreuses voies de travail. Nous espérons en faire écho dans notre Lettre de LaPetiteLibrairie.